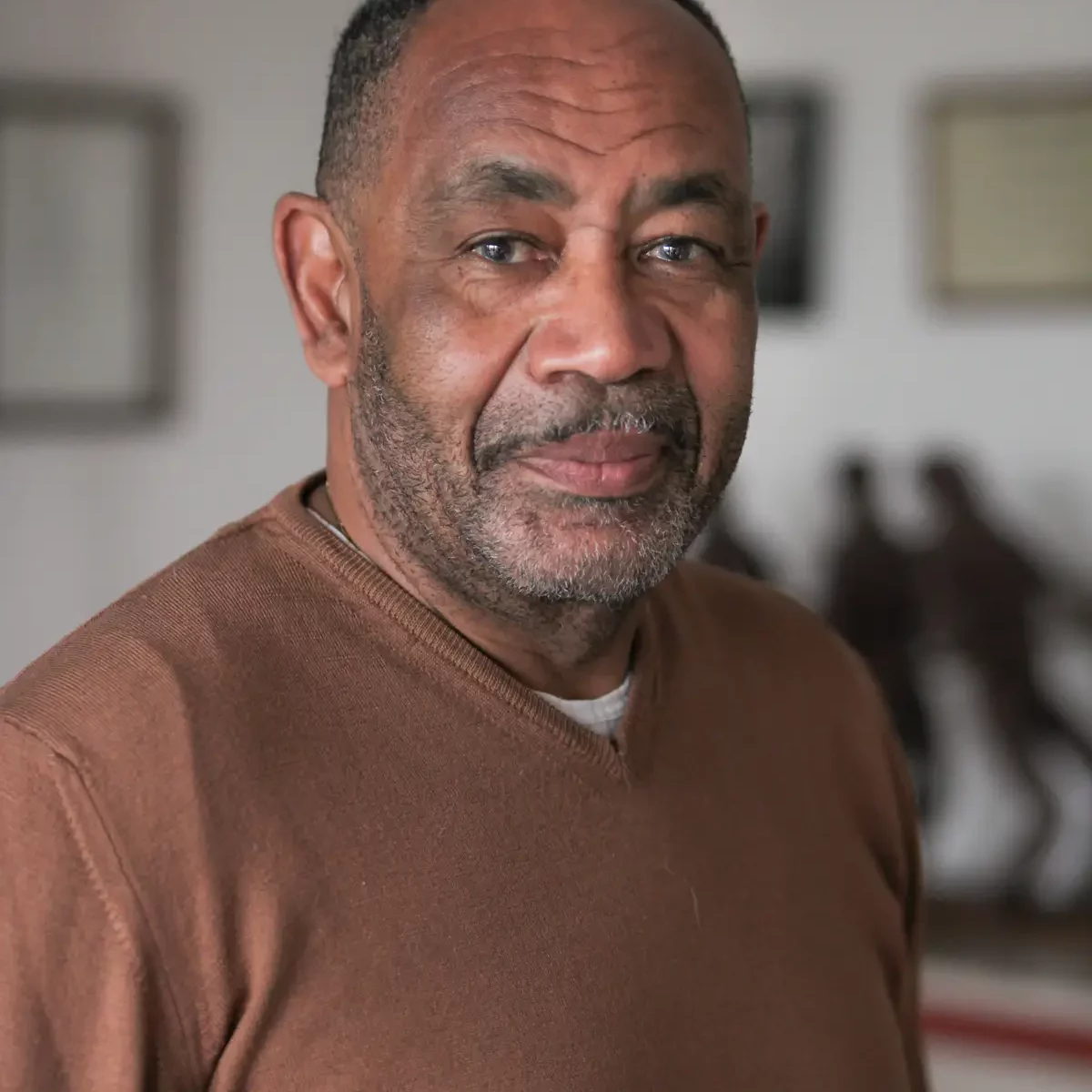« J’ai rejoint l’association Mémoire de l’Outre-Mer vers 1998, quand j’ai quitté la région parisienne pour être chef d’établissement à Paimboeuf – lieu hautement symbolique quant à l’histoire du commerce triangulaire à Nantes. Par le biais d’un professeur de mon établissement, j’ai rencontré l’association et son président, Octave Cestor. J’ai assez rapidement adhéré et je me suis impliqué de plus en plus au fil des années et de mes mouvements professionnels dans la région. Mon arrivée à la présidence en 2008 a coïncidé avec un changement de locaux, puisque nous avons rejoint le 89 Quai de la Fosse, devenu l’Espace Louis Delgrès, où nous organisons nos manifestations.
Nous travaillons à évoquer le patrimoine historique de la ville de Nantes, tout en étant attachés à défendre l’idée que les cultures plurielles devaient être mises en valeur et présentées au grand public. Dans ce sens, nous organisons notamment beaucoup d’événements autour de la littérature, en recevant des personnes prestigieuses, des grands écrivains de la cause noire, dont Angela Davis, Édouard Glissant, Alain Mabanckou, Maryse Condé… Par ailleurs, nous avons développé de nombreuses actions en direction des scolaires, en faisant des conférences et expositions dans des établissements ou dans nos locaux et en organisant un rallye tous les ans. »
Quelle est selon vous l’action la plus emblématique de Mémoire de l’Outre-Mer ?
« Indéniablement, je pense que s’il y a un Mémorial de l’abolition de l’esclavage à Nantes aujourd’hui, Mémoire de l’Outre-Mer y est pour beaucoup. Quand la statue commémorative que nous avions installée à 100 mètres d’ici, sur le Quai de la Fosse, a été profanée, cela a déclenché toute la réflexion, qui s’est construite de 1998 à l’inauguration du Mémorial, en 2012. Ce Mémorial est unique au monde, et représente un outil pédagogique qui a une portée très importante. »
Propos recueillis par Pascaline Vallée en mai 2022